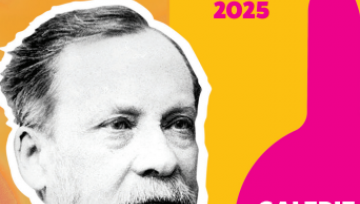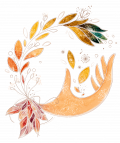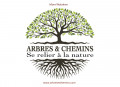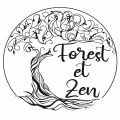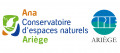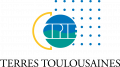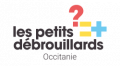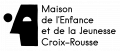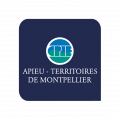Une présentation des chenilles processionnaires et de ses enjeux pour la santé.
Règlementations et politiques publiques
Mots clés- Ils peuvent être un appui pour un projet éducatif, donner de la légitimité à votre choix de sa mise en place.
- Les politiques publiques permettent de comprendre les enjeux ou les données territoriales et d'inscrire le projet dans un contexte plus large.
- Faire des propositions concrètes d'amélioration peut être l'objet d'un projet éducatif, comme lors de démarches de plaidoyer. Ainsi le projet éducatif peut contribuer à la prise de décisions dans les politiques publiques et peser sur elles
- Ils sont un moyen pour éduquer à la participation citoyenne en aidant les personnes à connaître les instances décisionnelles ou participatives, leur rôle et leur fonctionnement.
Pour l'aménagement des territoires, il existe des règles définies en fonction des politiques en place en matière d'urbanisme, d'habitat et de déplacements.
L'aménagement du territoire en France repose sur un ensemble de choix et d'actions menées par l'État, les collectivités territoriales (Région, Département, Métropole, etc.) et certains établissements publics, comme Epora, opérateur foncier d'État en Auvergne-Rhône-Alpes.
Organiser les villes : l'urbanisme
Pour organiser les villes, espaces de fortes concentrations de populations, d'habitations et d'infrastructures, plusieurs documents existent. Ils tiennent compte de l'organisation de l'hygiène publique (eaux usées, ramassage et traitement des déchets, etc.), de la gestion du bruit, de la densité des habitations avec un souci de promiscuité, du besoin de nature et de végétation, de la mobilité et l'accessibilité des infrastructures, de la qualité de l'air extérieur ou encore de la prise en compte du réchauffement climatique.
Les règles en matière d'urbanisation sont posées par le Code de l'urbanisme. Ce texte place la prise en compte de la biodiversité comme obligation réglementaire pour les collectivités.
Le code de l'urbanisme vise pas moins de cinq notions relatives à la protection écologique (…). Il s'agit des milieux naturels, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes et des continuités écologiques.
PLU(i) et biodiversité : concilier nature et aménagement, 2019
Plusieurs grands outils d'aménagement sont aussi prévus par la loi, déclinés selon des thématiques et des territoires variés.
Le plan local d'urbanisme (#PLU#), ou le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI), est le principal document de planification de l'urbanisme au niveau de la commune ou de l'intercommunalité. Il est prévu par la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains, dite « loi SRU » et s'inscrit dans le cadre du Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) qui prévoit par exemple la lutte contre l'étalement urbain. L'aménagement des villes est pensé par les politiques, les urbanistes, certaines associations. Il peut aussi être fait en concertation avec les habitants ; c'est ce qu'on appelle l'«urbanisme participatif».
De grands outils d'aménagement
Parmi les grands outils d'aménagement, plusieurs « plans » et « schémas » existent. Voici quelques exemples.
- le plan climat-air-énergie territorial (PCAET), qui concerne les intercommunalités de plus de 20 000 habitants. Il prévoit la mise en œuvre, sur son territoire, des objectifs internationaux, européens et nationaux en matière de qualité de l'air, d'énergie et de climat ;
- le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) qui concerne la préservation des ressources naturelles (biodiversité, habitats naturels, eau) et sert par exemple d'appui à la mise en place des trames vertes et bleues ;
- le schéma régional climat air énergie (SRCAE), proposé par les lois Grenelle, déclinant les directives européennes en matière de climat et d'énergie ;
- le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET), qui pose la stratégie et la prospective en matière d'aménagement du territoire. Les Scot et PLU doivent suivre ses intentions.
Le schéma de cohérence territoriale, Scot, sert à déterminer un projet en matière d'habitat, de mobilité, d'aménagement commercial, d'environnement et de paysage sur un territoire qui rassemble plusieurs communes ou sur une intercommunalité. Il s'inscrit aussi dans un PADD.
Des textes pour préserver les espaces naturels
Parmi les outils d'aménagement du territoire, certains sont particulièrement destinés à protéger les espaces naturels.
La Loi littoral, inscrite au Code de l'environnement, donne les règles en matière d'aménagement, de protection et de valorisation des côtes pour éviter la construction immobilière à outrance.
Les Parcs naturels régionaux (PNR), comme le PNR de Chartreuse ou le PNR des Volcans d'Auvergne, sont des espaces souvent interdépartementaux et interrégionaux. Ces Parcs sont initiés par des habitants, des élus et des associations qui se concertent en vue de protéger et de valoriser le patrimoine d'un territoire.
Il existe d'autres outils d'aménagement aux noms plus ou moins connus du grand public : permis de construire, études d'impact, contrats urbains de cohésion sociale (CUCS), etc.
Source : « Aménagement du territoire en France », Wikipédia.
Les acteurs et actions liés
Programme "One Health en Nouvelle-Aquitaine, du concept à l’action"
6 Quai de Paludate
33800 Bordeaux
France
Zero Waste Toulouse
Ressources en jeu
Association Sauvegarde Hérault Littoral
Sauvegarde Hérault Littoral
1 RUE KLEBER
34410 SERIGNAN
France
Promotion Santé Nouvelle-Aquitaine
Association Jardin de Cocagne - Lozère
GRAINE NOUVELLE AQUITAINE
Graine Nouvelle Aquitaine
8 r Abbé Gaillard
33830 Belin Béliet
France
Institut de formation des métiers de la santé
IFMS du LOT
351 rue Saint Géry
46000 Cahors
France
Délégation Sud-Ouest FFJNS
Promotion Santé Auvergne-Rhône-Alpes / Délégation Ain
247 chemin de Bellevue
01960 Peronnas
France
Réveiller les Liens
Reliances Nature
France Nature Environnement Occitanie Pyrénées
L'air que je respire : 2 ateliers pour les primaires d'Occitanie (2024-2025)
Atmo Occitanie - Antenne de Toulouse
10 Bis Chemin des Capelles
31300 Toulouse
France
L'air que je respire : 2 ateliers pour les collégiens d'Occitanie (2024-2025)
Atmo Occitanie - Antenne de Toulouse
10 Bis Chemin des Capelles
31300 Toulouse
France
BILOBA Santé - Conseil et Accompagnement
Atmo Occitanie
Atmo Occitanie - siège social
10 rue Louis Lépine
Parc de la Méditerranée
34470 PEROLS
France
Atmo Auvergne-Rhône-Alpes
Atmo Auvergne-Rhône-Alpes
3 allée des Sorbiers
69500 BRON
France
DROIT DANS SES BASKETS
Création et animation d’un outil de médiation itinérant, sur 3 espèces à surveiller : le Moustique tigre, la Tique et l'Ambroisie
Espace associatif Clément Marot
Place Bessières
46000 CAHORS
France
SERIOUS GAME « ENQUÊTE TOXIQUE »
CPIE du Haut Languedoc
Place De Lattre de Tassigny
34220 SAINT-PONS DE THOMIERES
France
Sensibilisation à l'environnement et à l'alimentation par les Arts du Cirque comme approche participative
Cirque & cAmpagnie
Le Village
32300 Saint Médard
France
Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement du Haut-Languedoc
Place De Lattre de Tassigny
34220 SAINT-PONS DE THOMIERES
France
Les moustiques débarquent
Parcours de formation-action en santé environnement pour les acteurs éducatifs toulousains
Toulouse
toulouse
31000 TOULOUSE
France
Un environnement plus sain pour nos bambins
Aveyron
25 avenue charles de Gaulle
12100 Millau
France
Environnement, environnes-nous !
AGIR pour la santé des générations futures
ACT'R Toulouse : réseau des acteurs de l'air
WaltR
14 avenue de l'Europe
31520 Ramonville Saint-Agne
France
La santé et moi : les pièces de ma maison
Centre socio culturel et sportif Jean Paulhan
72 Av. Mgr Claverie
30000 Nîmes
France
WaltR
14 avenue de l'Europe
Bâtiment Denver
Parc Technologique du Canal
31520 Ramonville Saint-Agne
France
Qualité de l'air intérieur : de quoi parle-t-on ?
Association Les Petits Débrouillards - Antenne du Gard
2 rue de Font Dame
30900 Nîmes
France
Perturbateurs endocriniens : tous concernés, tous mobilisés
Tournefeuille
Place de la mairie
31170 Tournefeuille
France
Une Assiette pleine de vie : promouvoir une alimentation favorable à sa santé et à l'environnement
10 Rue des Blanqueries
Appt 19
66200 ELNE
France
Expérimentation d’un programme d’animations multi-public de sensibilisation à une cuisine saine, bio et locale pour tous
FD CIVAM DU GARD
216 Chemin de Campagne
30250 Sommières
France
Fédération Départementale des CIVAM du Gard
Accompagner les jeunes de 8 à 16 ans dans la compréhension et l’adoption d’une diversification des protéines
7 rue du Cougaing
11300 Limoux
France
Escape game Sauve qui PE !
CLS Montagnes Catalanes - CC Pyrénées Cerdagne et Pyrénées Catalanes
CLS Montagnes Catalanes
4 rue du Torrent
66800 SAILLAGOUSE
France
CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE DU PAYS VOIRONNAIS
CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE DU PAYS VOIRONNAIS
40 RUE MAINSSIEUX
38500 VOIRON
France
Réseau régional de l'éducation à l'alimentation et au goût en région PACA
CRES Provence-Alpes-Côte d'Azur
178, cours Lieutaud
13006 Marseille
France
LEGTPA LOUIS PASTEUR
ARS Auvergne-Rhône-Alpes - Délégation départementale de la Drôme
ARS ARA DD26
13, Avenue Maurice FAURE
26000 VALENCE
France
Conférence proposée par Yvan-Marc Juillard : Les compétences des éco-lucides
Maison de la Nature
11 rue René Cassin
42100 Saint-Etienne
France
Nutry-Boogy
Structure d’expertise régionale obésité en Occitanie (Hôpital des enfants)
330 avenue de Grande Bretagne
31059 Toulouse
France
Association Lozérienne pour l'Etude et la Protection de l'Environnement
ALEPE
Montée de Julhers
48000 Mende
France
Sophie Fleckenstein
Les Secrets de la Nature
Bionheur En Herbe
Association des Collectifs Enfants Parents Professionnels Auvergne
ACEPP Auvergne
8, rue Jacques Magnier
63100 Clermont-Ferrand
France
Réseau Compost Citoyen Occitanie
AGENCE ENVIRONNEMENT & SANTE
Ligue de l'enseignement-FOL 43
Arbres et chemins
Commuauté de communes Entr'Allier Besbre et Loire
Communauté de Communes Entr'Allier Besbre et Loire
18 Rue de Vouroux
03150 Varennes-sur-Allier
France
INRAE (siège)
INRAE - Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement
147 rue de l'Université
75338 Paris 07
France
Nature & Biodiversité
Nature & Biodiversité - Ronsin Betty
282 rue de la Voute
73620 Hauteluce
France
Effets du réchauffement climatique sur notre santé : passons à l’action ! - à Céret
lycée de Céret
18 Av. des Tilleuls
66400 Céret
France
Le goût du sauvage
Mutualité Française Occitanie
Mutualité Française Occitanie
3, rue de Metz
31068 TOULOUSE Cedex 7
France
Réseau français d'éducation à la nature et à l'environnement
164 rue des Albatros
34000 MONTPELLIER
France
Envirobat Occitanie
CPIE Pays Gersois
Centre Permanent d'Initiative pour l'Environnement Pays Gersois
16 rue Delfort
32300 Mirande
France
ANA - CPIE Ariège
Ana-Conservatoire d'espaces naturels Ariège (ANA-CEN Ariège)
Vidallac
09240 Alzen
France
CPIE Terres Toulousaines
CPIE Terres Toulousaines
10 rue d'Arcachon
Centre commercial des Mazades
31200 Toulouse
France
Cocagne Alimen'Terre
Maison régionale de l'Environnement
2 rue de Valenciennes
31000 Toulouse
France
Sensibilisation et éducation à l'environnement sonore
Balades sonores : centre-ville + Villeneuve
11 boulevard Jean Pain
38000 Grenoble
France
Effets du réchauffement climatique sur notre santé : passons à l’action !
1 Boulevard de Clairfont
66350 Toulouges
France
Les Petits Débrouillards Occitanie - Antenne du Gard
Association Les Petits Débrouillards - Antenne du Gard
2 rue de Font Dame
30900 Nîmes
France
Mairie d'Aubenas
Dire
Agence Régionale de Santé ARA - Délégation Départementale de l'Ardèche
Avenue Moulin de Madame
07000 PRIVAS
France
Partageons les Jardins
Partageons les Jardins
105 boulevard Pierre et Marie Curie
31200 Toulouse
France
CPIE Bigorre-Pyrénées
CPIE Bigorre-Pyrénées
5 chemin du Vallon de Salut
65200 Bagnères-de-Bigorre
France
Aude Nature
Carrefour des Sciences et des Arts
Carrefour des Sciences et des Arts
10 Boulevard Gambetta
46000 Cahors
France
Attention Expo à Colomiers : Exposition sur la santé environnementale en Occitanie
Val d'Aran
6 - 8 - 10 allée du Tourmalet
31770 Colomiers
France
Attention Expo à Montauban : Exposition sur la santé environnementale en Occitanie
Coeur Bourbon
2 - 16 avenue Jean Jaurès
82000 Montauban
France
La Maison de l'Initiative
La Maison de l'Initiative
52 rue Jacques Babinet
31100 Toulouse
France
Les Petits Débrouillards Occitanie
Siège Les Petits Débrouillards Occitanie
49 boulevard Berthelot
34000 Montpellier
France
Autres Regards sur l'Environnement du Piémont Biterrois
ARE Piémont Biterrois
13 bis Place Pierre Sémard
34500 Béziers
France
Association des Collectifs Enfants Parents Ardèche Drôme et Haut-Lignon
acepp
80 Grand Rue
07170 Villeneuve de berg
France
Programme Habitat Santé Environnement « Bonnes pratiques pour une bonne santé »
155 Rue du Faubourg de Rochebelle
30100 Alès
France
Communauté de Communes Bastides de Lomagne
Communauté de Communes Bastides de Lomagne
Route d'Auch
Zone Artisanale
32120 MAUVEZIN
France
CPIE CLERMONT-DOMES
CPIE Clermont-Dômes
1 rue des colonies
63 122 SAINT GENES CHAMPANELLE
France
Action de prévention "la santé à vélo"
Société Régionale de Santé Publique Occitanie
CHU la Colombière, Département de l'Information Médicale
39 Avenue Charles Flahault
34295 Montpellier 5
France
Le Vieux Biclou
Le Vieux Biclou
5 rue de la Poésie, quartier des Beaux-Arts
34000 Montpellier
France
Escargot Migrateur
Ville de Grenoble
centre communal Camille Claudel
47 avenue Marcelin Berthelot
38100 Grenoble
France
Mise en réseau des acteurs de l'éducation au goût
DRAAF Occitanie
CA, 697 Avenue Etienne Méhul
34078 Montpellier
France
Promotion Santé Auvergne-Rhône-Alpes / Délégation Cantal
Promotion Santé ARA Délégation Cantal
61 bis avenue de la République
15000 Aurillac
France
Institut de Recherche pour le Développement
Institut de Recherche pour le Développement
911 avenue agropolis - IRD
Institut recherche pour le développement
34090 Montpellier
France
Promotion des couches lavables !
Association Madeleine Environnement
102, rue des Monts de la Madeleine
42155 POUILLY LES NONAINS
France
Natur'Envie
Frédéric Isselin (Natur'Envie)
817 route d'Englannaz
74210 FAVERGES SEYTHENEX
France
Roannais Aggl'imentaire
CAUE de Haute-Savoie
L'îlot-S - CAUE de Haute-Savoie
7 esplanade Paul Grimault
74000 Annecy
France
Maison de la Petite Enfance - Scionzier
Maison de la Petite Enfance
7 rue du Crétêt
74950 Scionzier
France
Connexion Nature
Fédération Départementale des CIVAM de la Drôme
FD des MFR Drôme-Ardèche
Fédération des MFR Drôme-Ardèche
4, rue de la Cure
26300 Châteuneuf/Isère
France
Union régionale des CPIE Auvergne-Rhône-Alpes
Batiment Synergie
245 rue Duguesclin
69003 LYON
France
Maison de l'Enfance et de la Jeunesse de Croix-Rousse
Maison de l'enfance et de la jeunesse
9 rue dumont d'urville
69004 Lyon
France
Drapps Occitanie
Osmose santé environnementale
Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et d'Environnement de l'Allier
CAUE
14 rue de Decize
03000 MOULINS
France
CODES 34
Des solutions durables de déplacement pour tous !
Déploiement d’un outil de repérage des impacts santé des projets d'aménagement : la grille URBAN-ISS
IFERISS - Faculté de médecine
37 allées Jules Guesde
31062 Toulouse 09
France
Grand Narbonne : santé et aménagement du territoire
Le Grand Narbonne
12 Bd Frédéric Mistral
11100 Narbonne
France
Action saturnisme dans les Pyrénées-Orientales
IREPS Occitanie
Place Lange Cité de la Santé
Hôpital La Grave
31300 Toulouse
France
Un espace ressource habitat pour quoi faire ?
Respirez-vous du radon dans votre logement ?
Maison de la Nature et de l'Environnement Pôle Culturel et Scientifique
155 faubourg de Rochebelle
30100 Alès
France
Le diagnostic à domicile : une réponse pour faire face à la précarité énergétique
3 Rue de la Frugère
30110 La Grand-Combe
France
Lutte contre la précarité énergétique dans les Pyrénées-Orientales
24, QUAI SADI CARNOT
66906 PERPIGNAN 04
France
La restauration scolaire durable dans les collèges publics du Gers
81 route de Pessan
BP 20569
32013 Auch 9
France
L’alimentation, un bon menu pour des EPI appétissants
Savoirs à semer et saveurs à partager
Terra Alter : un réseau de légumeries bio locales, pour les cantines de nos enfants
Terra Alter
Le Hameau du Lac Route du lac
32230 Marciac
France
Opticourses : un programme pour conjuguer nutrition et budget au quotidien
UMR MOISA (MOISA. MOntpellier Interdisciplinary research center on Sustainable Agri-food systems)
Campus Inra-SupAgro de la Gaillarde, 2 place Pierre Viala - Bât. 26
34060 Montpellier 2
France
AUAT-aua / Toulouse
GEFOSAT
Les Pieds à Terre
Association Les Pieds à terre
Rue du Château
43380 Chilhac
France
FREDON Occitanie
Centre Hospitalier Métropole Savoie
Commune de Bessay sur Allier
GRAINE Occitanie (site de Toulouse)
Réel – CPIE de Lozère
Association Biodiversité : Echanges et Diffusion d'Expériences
47 place du Millénaire
Appartement 74
34000 Montpellier
France
Terra Alter
Ministère de la Transition écologique
CREAI-ORS Occitanie
Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées
37 allée Jules Guesde
31000 TOULOUSE
France
FR CIVAM Occitanie
Maison des agriculteurs
bat B Mas de Saporta
CS 50023
34875 Lattes
France
INRAE
INRA : Institut National de Recherche Agronomique-Laboratoires
24 Chemin de Borde Rouge
31320 Auzeville-Tolosane
France
CPIE du Gard
Maison de la Nature et de l'Environnement Pôle Culturel et Scientifique
155 faubourg de Rochebelle
30100 Alès
France
Département des Pyrénées-Orientales
LISST
Laboratoire Interdisciplinaire Solidarités, Sociétés, Territoires (LISST) - UMR5193 Université Toulouse Jean Jaurès - Maison de
5, Allées A. Machado
31058 TOULOUSE 9
France
Agence Lozérienne de la Mobilité
CAUE 30
Réseau Empreintes
Maison des associations
23 avenue des Harmonies
Cran Gevrier
74960 Annecy
France
LAFI BALA
DRAAF Occitanie
Cité Administrative - Bât E
Boulevard Armand DUPORTAL
31074 Toulouse CEDEX
France
Rectorat de Montpellier
Ecole Nationale Supérieure de Formation de l'Enseignement Agricole de Toulouse-Auzeville
BP 22687
2 route de Narbonne
31326 Castanet Tolosan CEDEX
France
Fédération nationale d’éducation et de promotion de la santé
Maison des Sciences de l'Homme Paris Nord
20 avenue George Sand
93210 Saint-Denis
France
Holisme
ARS Occitanie
26-28 Parc club du Millénaire
1025, rue Henri Becquerel
34067 MONTPELLIER
France
Association Conscience et Impact Écologique - Isère
Cap Berriat
1 rue Victor Lastella
38000 Grenoble
France
Association Réseau Marguerite, cultivons ensemble un monde plus juste !
Locaux Motiv
10 bis rue Jangot
69007 Lyon
France
Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères du Nord Allier
SICTOM Nord Allier
RD 779 - Lieu-dit "Prends-y-Garde"
03230 CHEZY
France
Composteur de quartier Maison de la Nature
Maison de la Nature
11 rue René Cassin
42100 Saint Etienne
France
Réseau Drômois d'Éducation à l'Environnement
Maison de Quartier des Ors
26 rue Magnard
26100 ROMANS sur ISÈRE
France
Reseau Compost Citoyen Auvergne Rhône-Alpes
RCC AURA
322 route des Terres du Ruisseau
38710 Mens
France
Mairie de Montluçon
Mairie de Montluçon - Service Santé
26 Rue Paul Constans
03100 Montluçon
France
Education aux gestes barrières et éducation et promotion de la santé-environnement dans le contexte de la pandémie de Covid-19
5 rue anatole france
38400 Saint-martin-d'hères
France
Promouvoir un environnement sonore favorable à la santé ( Contrat Local de Santé)
ville de Saint-Martin-d'Hères
5 rue anatole france
38400 Saint-martin-d'hères
France
Ensemble contre le moustique tigre (Contrat Local de Santé )
ville de Saint-Martin-d'Hères
5 rue anatole france
38400 Saint-martin-d'hères
France
Direction Hygiène Santé Ville de Saint-Martin-d'Hères
Direction hygiène-santé - CCPEF
5 rue Anatole France
38400 Saint-Martin-d'Hères
France
SCHS Ville Roanne
Centre administratif Paul Pillet
place de l'Hôtel de Ville
42300 Roanne
France
Association Consommation, Logement et Cadre de Vie 63
Association CLCV 63
32, rue Gabriel Péri
Résidence la Liberté
63000 Clermont-Ferrand
France
Promotion Santé Occitanie (ex Ireps Occitanie)
Promotion Santé Occitanie
Place Lange
Cité de la Santé, Hôpital La Grave
31300 Toulouse
France
Société botanique Gentiana (Isère)
Anim' nature et jardin
Centre Socioculturel l'Equipage et Point info santé
centre socioculturel l'équipage
16 RUE DE ST GALMIER
42140 CHAZELLES SUR LYON
France
Dépollul'Air : acquisition et formation à l'outil
Oïkos : la maison, son environnement
60 rue du Jacquemet
69890 La Tour de Salvagny
France
Association Bise du Connest
Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers Auvergne Rhône Alpes
Siège social - CRCDC AuRA
58 rue Robespierre
42000 ST ETIENNE
France
Centre Social de Montbrison
LPO Auvergne-Rhône-Alpes - délégations Savoie et Haute-Savoie
46 route de la Fruitière
74650 Chavanod
France
Université Clermont Auvergne
UFR Pharmacie - Département Santé Publique et Environnement
28 place Henri Dunant
TSA 50500
63001 Clermont-Ferrand
France
LPO Isère
LPO AURA Délégation territoriale de l'Isère
5 place Bir Hakeim
38000 GRENOBLE
France
Association Conscience & Impact Écologique - Savoie
Antenne Savoie
67 rue Saint-François de Sales
73000 Chambéry
France
Association Conscience & Impact Écologique
Local CIE
9 avenue Piaton
69100 Villeurbanne
France
Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement des Monts du Pilat
Maison de l'Eau et de l'Environnement
405 chemin des Forêts
42660 Marlhes
France
COMMUNAUTÉ DE COMMUNE PAYS DU MONT BLANC
Communauté de communes Pays du Mont-Blanc
648, chemin des Prés Caton
P.A.E du Mont-Blanc
74190 PASSY
France
FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT LOIRE
Maison de la Nature
11 rue rené Cassin
42100 Saint Etienne
France
ARS Auvergne Rhône Alpes - Délégation de la Savoie
94 boulevard de Bellevue
73000 Chambéry
France
Formation des élu.e.s et technicien nes à la santé environnement
Centre Léon Bérard
28 rue Laennec
69008 Lyon
France
Desartsonnants
Santé Environnement Auvergne Rhône-Alpes
Maison de l'Environnement
14 avenue Tony Garnier
69007 LYON
France
Fédération Départementale des CIVAM de l'Ardèche
Domaine Olivier de Serres
1064 Chemin du Pradel
07170 Mirabel
France
Contribuer à réduire l’exposition à l’ambroisie
ARS Auvergne-Rhône-Alpes délégation de Haute-Savoie
Cité administrative
7 rue Dupanloup
74000 ANNECY
France
Les Amanins
Centre agroécologique LES AMANINS
1324 Route de Crest
26400 LA-ROCHE-SUR-GRANE
France
Maison de l'Eau et de la Nature
Maison de l'eau et de la nature
Place de Dornhan
01190 Pont-de-Vaux
France
Vers Un Environnement Sain
Ligue de l'Enseignement de la Loire
Roanne ou St Etienne
19 rue Pierre Semard
42300 Roanne
France
FRAPNA Ardèche
CENTRE SOCIAL SOLEIL LEVANT
CENTRE SOCIAL SOLEIL LEVANT
20 RUE DES AUBEPINES
42700 FIRMINY
France
CAP Tronçais
Fondation de Coopération Scientifique Rovaltain
Rovaltain
3 rue Henry Chalamet
26000 Valence
France
Secrétariat Permanent pour la prévention des pollutions et des risques dans l'agglomération grenobloise
17 Boulevard Joseph Vallier
38000 GRENOBLE
France
Rhizo'Sol
Agence Régionale de Santé - Délégation départementale de l'Ardèche - Service Santé-Environnement
Avenue Moulin de Madame
07000 PRIVAS
France
wecf France
13 Avenue Émile Zola
Cité de la Solidarité Internationale
74100 Annemasse
France
Relais d'Assistants Maternels "Les P'tits Dauphins"
5 route du stade
74100 Vetraz-Monthoux
France
Promotion Santé Auvergne-Rhône-Alpes / Délégation du Rhône
7 Place du Griffon
69001 Lyon
France
Syndicat Mixte du Beaujolais - Geopark Beaujolais
172 boulevard Victor Vermorel
69400 Villefranche-sur-Saône
France
Observatoire territorial des conduites à risque de l'adolescent
1221 Avenue Centrale
BP 47
38040 GRENOBLE 9
France
France Nature Environnement Ain
44 avenue de Jasseron
01000 Bourg-en-Bresse
France
Promotion Santé Auvergne-Rhône-Alpes / Délégation Drôme
22, place Arthur Rimbaud
26000 Valence
France
Oïkos : la maison, son environnement
60 CHEMIN DU JACQUEMET
69890 LA TOUR DE SALVAGNY
France
Promotion Santé Auvergne-Rhône-Alpes / Délégation Haute-Savoie
3 avenue de la Plaine
74000 Annecy
France
Nos enfants ne manquent pas d'air !
Nos enfants ne manquent pas d'air !
Promotion Santé Auvergne-Rhône-Alpes / Délégation Isère
23 avenue albert 1er de Belgique
Centre départemental de Santé
38100 grenoble
France
Promotion Santé Auvergne-Rhône-Alpes / Délégation Savoie
306 rue Jules Bocquin
73000 Chambéry
France
Promotion Santé Auvergne Rhône-Alpes / Délégation de la Loire
26 Avenue de Verdun
42000 St Etienne
France
Prévention des risques environnementaux liés à la qualité de l’air intérieur : ensemble respirons mieux !
247 chemin de Bellevue
01960 PERONNAS
France
France Nature Environnement du Rhône
22 rue Edouard Aynard
69100 Villeurbanne
France
Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement de Haute Auvergne
Château St Etienne
15000 AURILLAC
France
Qualité de l'air intérieur dans les lieux d'accueil des enfants et des jeunes
225 rue Alphonse Lacombe
42740 La Terrasse sur Dorlay
France
Réseau Education à l'Environnement Auvergne
Maison de la Nature et de l'Environnement
17 avenue Jean Jaures
63200 Mozac
France
Mutualité française Auvergne-Rhône-Alpes
Cité Internationale
67 quai Charles de Gaulle
69006 LYON
France
Promotion Santé Auvergne-Rhône-Alpes / Délégation de l'Ardèche
Pole Maurice Gounon
11 boulevard du lycée
07000 PRIVAS
France
CPIE Bugey-Genevois
Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
241 Rue Garibaldi
CS 93383
69003 LYON
France
Madeleine Environnement
102, rue des Monts de la Madeleine
42155 POUILLY-LES-NONAINS
France
Département Cancer Environnement du Centre Léon Bérard
28 rue Laennec
69008 Lyon
France